L’État de droit,
c’est quoi ?
En France, nous vivons dans un État de droit. Cela veut dire que le droit s’applique à tous : tout le monde bénéficie de libertés et doit respecter les règles, citoyens comme administrations.
L’État de droit : une garantie pour les citoyens
L’État de droit veille à ce que les règles qui garantissent nos droits et nos libertés soient respectées par l’administration et les citoyens. Il nous protège contre toute forme d’injustice, de tyrannie ou d’abus de pouvoir. Il crée les conditions d’une société où chacun peut vivre librement dans le respect des autres. Sans État de droit, c’est le règne de la loi du plus fort.
L’État de droit existe à trois conditions :
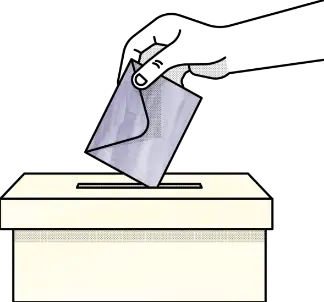
- Les règles de droit doivent être choisies de façon démocratique – elles doivent être décidées par des personnes désignées par le peuple ou directement par le peuple lui-même pour être légitimes – et garantir des libertés et droits fondamentaux.

- Les règles de droit doivent s’appliquer à tous sans distinction. Dans un État de droit, personne n’est au-dessus des règles, personne ne peut les éviter ou les contourner. Toutes les administrations – mairies, préfectures, écoles publiques, hôpitaux – et même le Gouvernement, sont soumis au droit comme n’importe quel citoyen français.

- Une justice indépendante doit exister pour vérifier que ces règles sont respectées. La justice doit pouvoir rendre des jugements impartiaux, sans influence extérieure, et ainsi veiller à ce que tout le monde respecte les règles de droit. Pour cela, ceux qui jugent ne doivent pas être ceux qui font la loi ou qui la font exécuter au quotidien : c’est la séparation des pouvoirs.
La séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice
Pour garantir le bon fonctionnement de la démocratie et de l’État de droit, et le respect des libertés de chacun, il est essentiel que les pouvoirs ne soient pas détenus par une seule personne ou une seule institution.
Imaginons une personne chargée à la fois d’élaborer la loi et de juger ceux qui l’enfreignent : elle pourrait modifier la règle pour condamner quelqu’un ou innocenter les personnes qu’elle souhaite, selon ses intérêts. Autre exemple : un gouvernement qui disposerait du double pouvoir de mettre en œuvre la loi et de juger son application. Il pourrait alors utiliser la justice pour éliminer toute opposition politique en s’assurant que les verdicts sont favorables à ses intérêts.
La concentration des pouvoirs amène à la tyrannie et permet l’exercice du pouvoir sans aucun contrôle. Pour prévenir ces risques, ceux qui font la loi ne doivent pas être ceux qui la mettent en œuvre au quotidien, ni ceux qui jugent qu’elle est correctement appliquée. C’est pourquoi en France, et dans toutes les démocraties, le pouvoir est divisé en trois branches, chacune confiée à des institutions différentes.
C’est ce qui garantit que la justice est indépendante en France et qu’elle rend des décisions impartiales.
Le pouvoir législatif
C’est lui qui fait la loi.
Qui l’exerce?
Le Parlement
(députés à l’Assemblée nationale et sénateurs au Sénat).
Le pouvoir exécutif
C’est lui qui applique, qui « exécute » les lois et qui met en œuvre la politique courante de l’État.
Qui l’exerce?
Le Gouvernement
(Premier ministre et ministres), avec le président de la République.
Le pouvoir judiciaire
C’est lui qui contrôle que la loi est respectée par les citoyens et les administrations et qui sanctionne s’il y a des infractions.
Qui l’exerce?
La justice (juridictions de la justice judiciaire et administrative).
Cette séparation des pouvoirs crée une situation d’équilibre : elle empêche chacune des trois branches d’adopter et de faire appliquer seule le droit, afin que personne ne puisse en abuser.
Deux justices en France : la justice judiciaire et la justice administrative
En France, la justice est divisée en deux : la justice judiciaire et la justice administrative.
- La justice judiciaire (tribunaux judiciaires, de commerce, cours d’assises, cours d’appel, Cour de cassation…) juge les conflits entre citoyens, entre organisations privées (entreprises, associations…), ou entre les citoyens et ces organisations privées.
- La justice administrative (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’État) juge les conflits qui opposent les citoyens ou les organisations privées aux administrations (mairies, préfectures, services publics, hôpitaux publics, écoles, Gouvernement…).